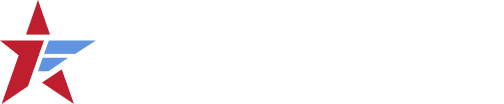Professeur Franz C. Mayer, titulaire de la chaire de droit public, de droit européen, de droit international public, de droit comparé et de droit et politique à l’université de Bielefeld.
Il suffirait de deux ratifications supplémentaires pour que le traité instituant la Communauté européenne de défense (CED) entre en vigueur (Art. 132 du traité de la CED).
Cependant, il existe d’importantes raisons de ne pas revitaliser ce vieux traité.
Cela commence par la signification et l’objectif du traité. La CED avait une perspective différente. À l’instar de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la CED visait à réunir des États auparavant hostiles de telle sorte que la guerre devienne impossible ou du moins difficile. Les ingrédients de la guerre, l’énergie et l’acier, étaient retirés aux États-nations et placés sous un contrôle supranational. La CED était la suite logique de cette démarche : non seulement les ingrédients de la guerre, mais aussi les armées nationales elles-mêmes devaient être placées sous un contrôle supranational. Cette perspective était introspective : les Erbfeinde, « ennemis héréditaires », que sont l’Allemagne et la France, devaient être rapprochés par l’intégration de manière à mettre un terme à la série de guerres entre ces voisins au cœur de l’Europe. Si cette logique était appliquée aux conflits actuels, tant l’Ukraine que la Russie devraient rejoindre une structure commune. Toutefois, une telle perspective n’est pas à l’horizon. Aujourd’hui, l’objectif premier de la CED serait clairement de garantir les capacités de défense européennes face à la Russie.
À première vue, la réactivation d’un traité aussi ancien ne semble pas très plausible, étant donné que tant de choses ont changé en Europe au cours des 70 dernières années. Le droit des traités traite cette question avec la clause rebus sic stantibus (Art. 62 de la CVDT).
Mais, à proprement parler, l’accent n’est pas mis sur un traité. L’idée est de s’appuyer sur les ratifications existantes. Après tout, la France et l’Italie devraient encore prendre l’initiative politique et ratifier toutes deux le traité. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il entrerait en vigueur, qu’il serait politiquement mis à jour, pour ainsi dire. Le fait que rien ne dépende de l’Allemagne pour le moment ne correspond pas seulement à la position passive adoptée par les Allemands sur les questions militaires au fil des ans. Cela aurait également l’avantage que les objections constitutionnelles habituelles de l’Allemagne à toute nouveauté dans le contexte européen et l’inévitable soumission à la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui pourraient éventuellement faire obstacle, soient pour l’instant sans importance. L’Allemagne a ratifié le traité, est formellement liée par celui-ci et ne peut pas facilement révoquer cette ratification. Il n’y a également pas de moyen simple de saisir la Cour constitutionnelle allemande dans cette constellation. Fait amusant : la Cour constitutionnelle allemande s’est déjà prononcée sur la CED en 1952, bien que l’affaire ne soit pas allée très loin en raison d’un manque de qualité juridique.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du traité, la CED devrait bien sûr être mise à jour. Pour ce faire, une conférence intergouvernementale devrait être convoquée immédiatement pour mettre à jour et compléter le texte du traité. Voici un exemple parmi les nombreuses questions qui se posent : comment assurer le contrôle parlementaire au niveau européen ? Confier cette tâche aux PE des 27 États membres alors que seuls six d’entre eux sont impliqués dans la CED n’est pas très plausible.
Et à ce stade, il faudrait tenir compte des paramètres constitutionnels qui ont évolué depuis 1952. Le principe d’une armée parlementaire s’applique aujourd’hui à l’armée allemande : aucun déploiement de la Bundeswehr à l’étranger sans l’accord préalable du Bundestag. Ce n’est pas seulement en Allemagne que l’abolition des armées nationales envisagée dans le cadre de la CED risque de rencontrer des réserves claires quant à la souveraineté aujourd’hui. Pour l’Allemagne, c’est l’arrêt Lisbonne de la Cour constitutionnelle allemande qui contient des passages allant dans ce sens.
Néanmoins, l’exemple du traité Euratom montre qu’une communauté européenne peut continuer à exister parallèlement à l’Union européenne. Cependant, Euratom n’est pas le seul modèle concevable pour la coexistence de la Communauté et de l’Union : dans le cadre de la conférence intergouvernementale, l’élargissement de la CED à d’autres États pourrait également être un sujet de discussion. Il s’agirait en premier lieu d’États membres supplémentaires de l’UE, mais l’inclusion d’États non membres tels que le Royaume-Uni, et peut-être même l’Ukraine à l’avenir, serait également envisageable.
L’avantage de la CED serait d’offrir un nouveau point de départ pour le développement futur de la défense et de la sécurité européennes. Un nouvel élan. Dans le cadre du traité de l’UE avec 27 États membres, tout développement ultérieur risque d’être lent et difficile. En même temps, le concept d’avant-garde pourrait être testé ici avec la CED, certains États jouant un rôle de pionnier dans les questions d’intégration européenne.
Certes, la voie de la CED ne serait pas exempte d’obstacles et de problèmes. Ceux-ci semblent toutefois pouvoir être résolus. Il faudrait avant tout une volonté politique correspondante.